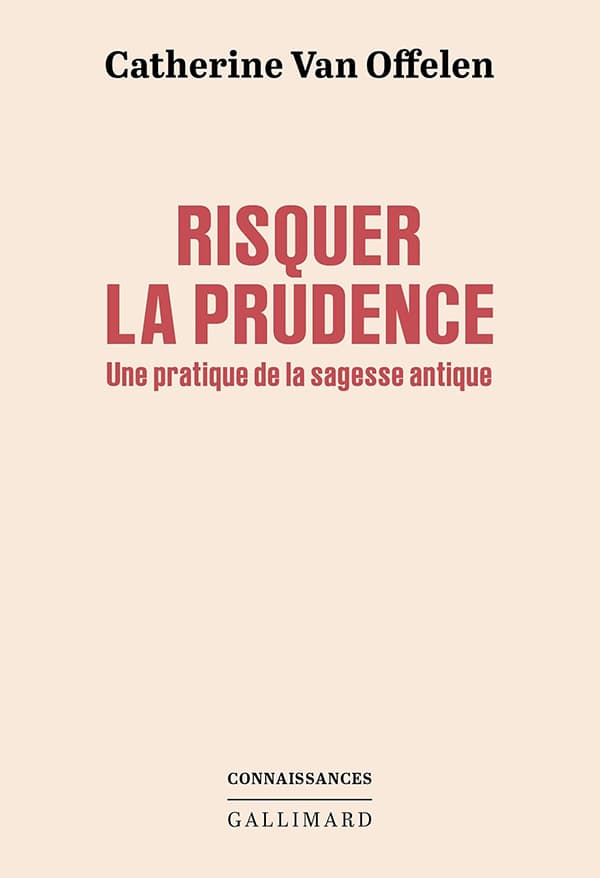
Éditions GALLIMARD
Risquer la prudence
Un ouvrage de Catherine Van Offelen.
Une recension de Denis Mechali.
Écouter l’accroche de cet article
Et si la prudence n’était pas un frein, mais un risque à prendre ? Dans « Risquer la prudence », Catherine Van Offelen, d’une plume limpide et enthousiaste, nous convie à redécouvrir cette pratique de la pensée comme une voie d’engagement lucide dans un monde troublé : la « phronésis » (φρόνησις en grec ancien), cette vertu antique qui devrait nous aider à prendre les bonnes décisions, à faire les justes choix. À rebours des idées reçues, la prudence n’est pas la peur d’agir, mais la capacité à discerner, à décider avec justesse dans l’incertitude. Nourri par la philosophie grecque, ce livre en explore la portée éthique et politique, et invite à repenser nos choix à la lumière d’une sagesse qui conjugue lucidité, audace et responsabilité. Une lecture stimulante pour qui cherche à conjuguer action et réflexion dans un monde en quête de repères. Une méditation subtile, à la croisée de l’éthique, de la politique et de la philosophie.
Denis Mechali
- Temps de lecture estimé à 21 minutes
Un coup de foudre intellectuel
Ce livre m’a enthousiasmé. Par le fond de ses idées, par le souffle qui anime les convictions de son autrice, et par la grâce poétique de sa langue. Un sens de l’image et de la formule, constants, rendant vivantes, accessibles et dynamiques des notions qui auraient tout pour être abstraites ou rébarbatives.
C’est le premier livre de sa jeune autrice, repérée notamment par Roger-Pol Droit, critique de la rubrique « philosophie » du journal « Le Monde ».
Le grand malentendu du mot « prudence »
Voici ce qu’écrit Roger-Pol Droit, le 2 mai 2025 :
« Un mot peut tuer, lorsqu’une traduction signifie trahison et finit par désigner l’inverse de son sens initial. Ainsi du mot « Prudence ». Pour les Grecs, après Aristote, la notion signifie « action intelligente qui combine réflexion et hardiesse, prise de risque et contrôle, lucidité et audace ». Ulysse chez Homère, Périclès à Athènes l’incarnent de manière exemplaire. Mais le mot « prudence » a trahi l’idée. Il signifie désormais pour nous la retenue, la réserve, la pusillanimité. À la place de l’audace, la précaution. Au lieu de l’élan, la bride. À l’inverse du risque, la sécurité. Ainsi, la traduction moderne est un étouffoir. »
Et Roger-Pol Droit conclut sa chronique avec une verve qui semble être le décalque – peut-être inconscient – du style de Catherine Van Offelen :
« Quand elle parle de rationalité souple et d’intuition raisonnée, elle esquisse avec ardeur un art de la décision qui semble faire cruellement défaut aux contemporains. Dans le semi-chaos où nous vivons, elle exhorte à agir malgré le doute et à décider dans l’incertitude, à combiner sentiments et calculs, au lieu de les opposer. Voilà qui pourrait bien, effectivement, se révéler indispensable. »
L’effet d’entraînement d’une écriture séduisante
Je n’arriverai probablement pas à transmettre l’enthousiasme que m’a procuré la lecture de ce livre, et pourquoi j’en tire effectivement un encouragement important, dans ces temps de violences et d’incertitudes que nous traversons.
Mon impuissance est liée au fait que le livre répond à des interrogations ou des doutes personnels, forcément intimes et tissés de toute mon histoire, logiquement différents de l’histoire de chacun des lecteurs. L’autre raison étant l’effet d’entraînement par le style lui-même, par la langue poétique et les images percutantes, dont je ne pourrai donner qu’un petit reflet par les citations.
Ma meilleure chance sera de donner envie de lire ce livre, qui révèlera aux nouveaux lecteurs si le charme opère sur eux, ou si, décidément, il n’était lié qu’à mon ressenti personnel.
Le piège de la séduction intellectuelle
On pourra éventuellement dire que je suis tombé dans le piège, car il y a un jeu de séduction évident de Van Offelen, qui consacre tout un chapitre à l’éloquence, à la part manipulatrice possible, mais séductrice aussi du langage, qui peut faire prendre « des vessies pour des lanternes » et amener à croire le faux.
Elle en donne elle-même de multiples exemples. Après Périclès, à Athènes, à la tête de la cité, vient Alcibiade, charmant jeune homme, amoureux de lui-même, et qui n’amènera que vanité, mensonges et malheurs.
L’éloquence peut cependant décrire un réel possible, qui emmène au-delà de soi, et donne une chance à cet imaginaire de se réaliser.
Des modèles prestigieux en exemple
Van Offelen évoque en permanence des modèles prestigieux, antiques comme Ulysse, Périclès ou Alexandre, ou plus modernes comme Napoléon, Churchill ou De Gaulle. Ces grands hommes ont tous donné des exemples de « prises de risques calculés », avec une part non seulement d’incertitude, mais parfois même de pure spéculation.
L’appel du 18 juin 1940 de Charles De Gaulle en est un exemple lumineux. Ce général inconnu, qui, en pleine débâcle de la France, appelle à résister, en invoquant une défaite inéluctable de l’Allemagne et du nazisme, tient des propos « fous », mais c’est une folie qui accouchera quatre ans plus tard d’une réalité, venant confirmer l’intuition et le pari de départ.
L’art de devenir des petits « phrónimoi »
L’oscillation du livre se fait en permanence entre ces modèles écrasants pour les individus moyens que nous sommes, bien loin de ces spéculations historiques grandioses, et la possibilité pour nous aussi de devenir des petits « phrónimoi », des êtres de prudence aristotélicienne, à notre échelle, à notre mesure, par un travail lent, progressif, déterminé.
L’autrice se met un peu en scène elle-même, avec son propre parcours de jeune femme de 35 ans, ses doutes puis ses certitudes progressivement construites, avec l’aide d’une universitaire à laquelle elle rend hommage dans le livre et en conclusion, Emmanuelle Danblon, elle-même disciple du philosophe belge Chaïm Perelman.
Sans s’épancher davantage, elle n’hésite pas à parler de l’amour, de ses tourments, de la passion et de ses erreurs, mais pour en tirer l’idée que les erreurs peuvent nous aider à grandir, nous faire grandir par la leçon que nous en tirons, pour avancer encore, sans se laisser entraver ou décourager.
Et pour les petits curieux, elle est actuellement la compagne de l’écrivain voyageur Sylvain Tesson.
Structure du livre : dix chapitres pour redécouvrir la phronésis
Le livre contient 10 chapitres, dont les titres éclairent chacun une facette du projet :
- Comment décider d’être soi ?
- Comment définir l’indéfinissable « phronésis » ?
- Comment en retrouver le trésor oublié ?
- Comment déchiffrer l’écriture du monde ?
- Comment rendre la prudence audacieuse ?
- Comment agir sur le monde ?
- Pourquoi la parole est-elle le Dieu des instruments ?
- Comment la phronésis a-t-elle perdu son âme ?
- Comment a triomphé le « principe de précaution » ?
- Comment décider dans un monde incertain ?
Redéfinir la phronésis : un art de l’action intelligente
Dès l’introduction, le problème est posé : comment agir face à l’incertitude du monde ? La réponse par la phronésis semble incongrue. Le mot est inconnu. Si on en cherche le sens, on trouve « vertu de prudence », ce qui évoque la timidité, la retenue, l’inaction. Erreur et contresens ! La phronésis est au contraire le flair dans l’action, l’art de s’adapter aux circonstances, la sagacité de celui qui discerne le bon chemin à prendre dans le clair-obscur du réel. Il s’agit en fait de lier des qualités qui sont souvent décrites comme opposées : la rigueur et la souplesse, la ruse et la noblesse, la raison et les émotions, le flair et l’expérience.
Et le contresens a contaminé la réalité. La prudence a fini par se confondre avec « le principe de précaution », et aboutir à une pusillanimité qui paralyse l’action.
La phronèsis est un principe d’action, incitant à prendre des risques, avec une part inévitable d’incertitude, et donc de risques d’échec, mais avec ces risques calculés et limités par l’ensemble des qualités tirées du savoir, de l’expérience et de la volonté du « phrόnimos » (φρόνιμος en grec ancien). Nous garderons à l’esprit que la réussite sourit généralement aux individus qui décident de se faire confiance.
Du chaos personnel à la méthode : le parcours de l’autrice
Le chapitre suivant parle du doute, des doutes de l’autrice, qui se trouvait au départ « comme un caméléon posé sur un kaléidoscope, de quoi devenir fou » !
Elle parle de la crise de l’époque, de la difficulté de trouver un sens dans cet océan de savoirs et de propositions, de la paralysie entraînée tant par une rationalité érigée en dogme que par un relativisme tout aussi bloquant, s’il interdit de hiérarchiser les choses.
Le livre avance ainsi : Il utilise un savoir universitaire, encore assez frais, vu l’âge de l’autrice, mais son objectif est de montrer l’utilisation possible dans la vie quotidienne de ce concept-méthode, loin des savoirs arides et désincarnés.
Aristote et la sagesse de l’action
Ensuite, un long chapitre est consacré à Aristote et à ce qu’il entend par ce savoir prudentiel particulier, mélange d’intelligence et de souplesse, pour s’adapter à l’infinie incertitude du monde. C’est une pensée, mais une pensée en mouvement, et une pensée tendue vers l’action, refusant de rester pure spéculation. Une sagesse de l’action donc, et un consentement au risque, et aux risques, du choix. L’action doit donc s’accompagner et être précédée de la méditation, qui permet d’envisager les tenants et aboutissants, risques d’échec inclus, puis d’avancer avec détermination, en ayant, au mieux possible, minimisé les risques. « Un coup de dés jamais n’abolira le hasard » (*) de la décision, comme on l’a vu avec l’exemple de De Gaulle. Mais ces exemples ne doivent pas non plus écraser. Il est possible d’utiliser l’outil de la phronésis en « Napoléon du minuscule », dans nos petites vies, pour exercer des choix et avancer. En bonne pédagogue, Van Offelen n’hésite pas à se répéter, afin d’enfoncer son petit clou dans nos crânes, qu’elle sait rebelles !
(*) Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (poème de Stéphane Mallarmé – 1897)
Ulysse, héros de la phronésis
Finalement, notre boussole antique est plutôt à chercher du côté d’Ulysse. Ce héros est très humain, dans ses passions et ses actions, dans sa capacité à mobiliser la ruse, et parfois la tromperie ou la violence, pour avancer au milieu des périls.
Après dix ans d’errance, il revient à Ithaque. Il est reconnu par son vieux chien, par la nourrice qui s’était occupée de lui enfant, et par Pénélope, qui utilisera toutefois elle-même une ruse, le secret partagé d’un lit conjugal formé d’un arbre indéracinable, pour être sûre de reconnaître Ulysse dans le vieil homme usé qui paraît devant elle.
Chaïm Perelman : la phronésis face à la barbarie
Chaïm Perelman est un philosophe du XXe siècle, qui vivait et réfléchissait dans les temps du nazisme et de ses crimes. Avec son épouse, il a été un grand acteur de la résistance juive au nazisme en Belgique.
Il observe comment les efforts de rationalité des Lumières, puis des XIXe et XXe siècles, ont été impuissants à conjurer les horreurs et le drame. Pour affronter la complexité, pas d’autre solution, selon lui, que le mélange de l’intelligence et de la ruse, donc cette « prudence » particulière, loin de tout angélisme, mais loin aussi de la paralysie et de l’inaction.
Et pour nous, un humanisme capable d’avancer, à côté de – et non soumis à – l’intelligence artificielle, avec son lot de « victoires statistiques ».
La « métis » ou l’art de l’ambiguïté créatrice
La phronésis a donc partie liée à la « métis » (en grec ancien, la μῆτις), la ruse, on peut carrément dire : la roublardise. Elle est, en effet, liée également à Hermès, messager des dieux, protecteur des voyageurs… et des voleurs, Dieu polisson et chapardeur parfois…
Aucune contradiction en définitive. Il s’agit de prendre acte d’une réalité extérieure, de s’y adapter, mais sans devenir cynique, en gardant sa propre boussole intérieure et son système de valeurs.
Ulysse, un esprit « poikílos »
Ulysse est aussi un esprit « poikílos » (ποικίλος en grec ancien). Ce mot, qui veut dire chatoyant, bigarré, aux mille couleurs, illustre le côté un peu insaisissable de la phronésis, un art certain de l’ambiguïté. Voici ce qu’écrit à ce sujet Catherine Van Offelen :
C’est une part du génie grec d’accepter l’ambivalence et c’est cette nature ondoyante qui lui permet de s’adapter à la complexité du monde, d’aller au-delà des apparences pour poser des jugements subtils et nuancés et symboliser « un juste milieu entre idéalisme et cynisme ».
Raymond Aron, le maître des nuances
Catherine Van Offelen n’y fait pas allusion, mais, pour ma part, ce tissage en « oxymore », soit donc en contradictions assumées et surmontées, rappelle ce qu’explique Cyrulnik (voir notre précédent article) concernant la résilience : un tissage complexe et personnel, difficile, mais accessible.
Elle-même cite Raymond Aron, pour lequel « le choix en politique n’est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable ». Par rapport à son « petit camarade » Sartre, la lucidité politique d’Aron est aveuglante, mais seulement pour ceux qui veulent bien le voir.
Encore en 2025, la pensée de la nuance déplaît, et beaucoup se rassurent en voyant Aron, contre toute évidence, comme « un écrivain du Figaro », soit un « fieffé homme de droite ». Les présupposés idéologiques aident puissamment à escamoter les évidences de la lucidité.
Le flair du chasseur et l’intuition raisonnée
Le livre envisage ensuite le flair du chasseur tapi dans la brousse, sachant interpréter les traces infimes du gibier qu’il traque, ou qui pourrait l’attaquer. Dans une image hardie, l’autrice compare ce flair et ces intuitions à nos capacités quotidiennes à « jauger » à première vue une personne à de multiples indices minuscules, et, assez souvent, à ne pas nous tromper.
Les personnes « phrόnimoi » ont souvent cette capacité à voir au-delà des apparences, et à voir juste. Au XIXe siècle, un expert fameux savait repérer sans erreur les copies ou les faux tableaux. Sa technique se basait sur l’étude attentive de détails infimes, mais révélateurs du tableau. Il n’était pas « devin », son savoir était rationnel, mais il était aidé par le flair et l’intuition, avant que ces qualités précieuses ne soient rejetées comme suspectes, voire méprisables.
« Célébrer les noces de la raison et de l’intuition »
Dans une remarque surprenante, Van Offelen explique que nous sommes submergés d’informations, nos sens débordés par ce flux d’informations, désormais issues aussi de l’intelligence artificielle, mais que cette « augmentation » supposée est en réalité une « diminution », si nous ne faisons plus confiance à nos qualités d’analyse et d’intuition.
L’autrice nous propose dès lors de « célébrer les noces de la raison et de l’intuition ». Elle cite à sa rescousse Antonio Damasio, qui dit que pour prendre une décision, il nous faut une émotion. Mais il s’agit alors de ne pas se laisser submerger par cette émotion et de la placer à une juste distance.
Si on refuse cela, cette « fleur de l’intuition », on laisse souvent pousser « l’ortie » d’un doute mortifère, récusant toute rationalité, et ouvert aux théories du complot. Dans ses textes, Chaïm Perelman liait assez directement un rationalisme exacerbé et dévoyé à la montée réactionnelle du nazisme.
Comment, dès lors, rendre la prudence audacieuse ?
L’autrice s’interroge : La phronésis serait-elle un robinet d’eau tiède ? La quête d’absolu fait partie de la quête des adolescents, mais débouche souvent sur des malheurs ou de cruelles déceptions. L’hubris, l’excès amené par certaines réussites, conduit souvent au désastre.
Le « Connais-toi toi-même » de l’oracle de Delphes n’est pas un appel à l’inaction, mais à la compréhension de ses propres limites, de ses forces et de ses faiblesses.
L’art de l’essai-erreur
Le « phronimos » avance souvent par essais et erreurs – mais en sachant réfléchir ses erreurs pour les dépasser – car le jeu d’équilibre ne peut pas être toujours gagnant.
L’autrice cite Albert Camus et un texte dans Noces nommé « L’exil d’Hélène », où il rappelle cette capacité des Grecs de l’âge classique à se replier sur une pensée raisonnable, consciente de ses propres limites.
Mais alors, courage ou lâcheté ? Les deux, mon capitaine ! Il est parfois nécessaire d’avancer malgré le risque, et parfois plus judicieux de ne pas se précipiter tête baissée dans un précipice, et d’avoir le « courage d’être prudent »…
La phronésis vise l’efficacité. Mais, être sûr de soi, presque arrogant, n’est pas non plus synonyme d’hubris. La confiance en soi peut se justifier. De nouveau, gare aux contresens paralysants ! Et vive la nuance !
L’artisanat de l’âme contre les « penseurs sans mains »
Revenons à Ulysse et rappelons-nous qu’il est aussi un artisan, un bricoleur parfois. Le « cheval de Troie » en témoigne. La phronésis est aussi un « artisanat de l’âme ». Les savoirs universitaires décident souvent de se passer de cette partie des savoirs, réputés suspects ou minables.
Les multiples exemples de créateurs qui sont refusés par l’université, ou qui la fuient volontairement, avant de s’épanouir et de révéler leurs dons créateurs ailleurs, illustrent de façon répétitive ces mécanismes. Charles Péguy se méfiait des « penseurs sans mains ».
L’éloquence : « Le dieu des instruments » ?
Le chapitre suivant aborde cette « arme de persuasion massive » qu’est l’éloquence, le « Dieu des instruments ». Et de nouveau on retrouve les oscillations entre les paroles mensongères et celles de la vérité, mais aussi la nécessité de masquer, ruser, tromper parfois, car il y a contradiction entre l’exigence de vérité et l’instabilité du monde. Héraclite disait : tout coule (πάντα ῥεῖ), l’objet bouge, et le sujet aussi.
L’exercice déstabilisant des sophistes
Les sophistes sont souvent sur cette corde raide entre vérité et mensonge. Van Offelen dit drôlement :
Il faut s’imaginer en train de défendre successivement l’euthanasie, puis son interdiction, d’argumenter sur la réalité du changement climatique, puis de le nier !
Ce type d’exercices aide en fait l’esprit à une certaine souplesse, à lutter contre la pesanteur des opinions, et contre la propension naturelle au dogmatisme. La phronésis est un équilibre.
Elle dit encore d’elle-même :
Je suis comme la fileuse ravaudant une étoffe, le texte est un écheveau, une trame, une tapisserie aux milliers de fils.
Aristote contre Platon
Platon détestait les sophistes, il les voyait comme de fieffés menteurs. Il avait raison et tort. Mais il faut donner raison à Aristote contre Platon. Prendre le risque de ces mensonges et manipulations, pour faire avancer une pensée forte et nuancée, histoire de ne s’enfermer ni dans un rationnel desséchant, ni dans une pureté inefficace. Mais, pendant 2000 ans, Platon a gagné. La phronésis a été suspecte, puis rejetée. Le comble a été atteint dans notre époque moderne, où la montée des risques, bien réels, a accouché du « principe de précaution », version desséchée de la prudence de la phronésis.
Mais comment en sommes-nous arrivés là ?
L’angoisse du risque et le « désir de murs »
Les risques sont devenus si angoissants que nous voulons à tout prix nous en prémunir, au prix d’une servitude volontaire souvent, d’une acceptation docile de diktats, parfois plus guidés par l’angoisse que par une claire conscience d’un danger tangible.
Van Offelen rapproche ce mécanisme de notre « désir de murs ». Les murs aux frontières d’Israël, ou entre États-Unis et Mexique, et bien d’autres, reflètent ces réponses maximalistes au risque et à l’angoisse.
Nos longues attentes aux portiques des aéroports ont des liens, au quotidien, avec cette volonté de précaution qui ne sait plus s’arrêter. La « mathématique du risque tend à installer l’individu moderne dans une conscience suraiguë de la dangerosité de toutes choses ».
L’hubris de la précaution
En 2022, la crainte d’une épizootie aviaire a conduit à abattre préventivement 50 millions d’oiseaux. Il y a sans doute une « hubris » dans l’acceptation de ces tueries de masse, au nom d’un risque à prévenir.
Et cet état d’esprit empêche, en miroir, d’observer et de jouir des bénéfices de la modernité et des progrès. La technologie qui permet à un paraplégique de se remettre debout et de commander sa marche est un progrès extraordinaire. Les effets pervers ou les bénéfices indus qu’en tirerait la firme qui la commercialise ne doivent pas masquer la « magie » du progrès.
Et une complicité – ou un cercle vicieux – se noue désormais entre attente des citoyens et décisions des politiques. Le futur envisagé se borne à envisager des remparts.
La sérénité du phronimos face à la tempête
Le chapitre suivant interroge cette perception de la dangerosité du monde, et rappelle en parallèle que le « phronimos » n’est pas aveugle ou naïf. Il est serein, non pas parce qu’il nie les tempêtes présentes ou à venir, mais parce qu’il fait confiance à ses ressources pour s’en sortir. « Sa phronésis est une tranquillité de l’âme ».
Paul Virilio fait remarquer « qu’inventer le train, c’est inventer le déraillement, inventer le navire, c’est inventer le naufrage, et que progrès et catastrophes sont les deux faces d’un même objet ».
L’inflation de normes conduit les États démocratiques à une paralysie de l’action, dont les retours de bâton excessifs, populistes ou complotistes, sont une conséquence malheureuse, mais pas forcément si étonnante.
Cependant, la réponse par la phronésis, si elle est accessible, est aussi exigeante, et on comprend qu’elle ne puisse s’imposer largement. Élargir la tache d’huile, convaincre au plus largement possible autour de soi, est néanmoins possible.
Dernier chapitre du livre : comment décider dans un monde incertain ?
L’autrice met en garde contre les excès de la quantification, de la statistique, devenant péremptoires et réponses « TINA » (Comme Margaret Thatcher, répétant « There Is No Alternative »). L’INSEE devient « la pythie moderne ». La surabondance des savoirs disponibles, via internet puis l’IA nous angoisse. Nous pensons y répondre par la « numérisation du monde ». Mais mesurer le débit du fleuve ne va pas conjurer son débordement. Les rapports du GIEC s’accumulent sans que les informations modifient le réel, voire pire ! Ils en arrivent à susciter une réaction de refus et de rejet.
L’individu « phronimos » n’est pas plus intelligent ou plus malin que les autres. Il ne possède pas d’informations inaccessibles aux autres. Simplement, il fait le constat des avantages, et pas seulement des risques, et décide un pari d’action. « Nul doute que, guidé par l’intelligence artificielle, Ulysse serait resté chez la charmeuse et charmante Calypso ». Mais l’IA et les algorithmes ne connaissent pas le doute, les sentiments et les ambiguïtés de l’être, qui amènent Ulysse à poursuivre son projet malgré tout. L’autrice veut croire, ou nous incite à croire, que c’est aux phronimoi, les « risqueurs prudents » que sourira la Fortune.
L’amour, cette « terra incognita »
Quelques pages sont consacrées à l’amour, cette folie délicieuse. « En lisant Le Misanthrope, on se dit qu’Alceste aurait mieux fait de se casser une jambe que de rencontrer Célimène » ! Mais il y aurait grandement perdu, et « on se dit que, loin d’être l’apanage d’adolescents romantiques, l’amour ne peut véritablement être vécu que par des âmes fortes, capables de fouler une terra incognita ».
« On voudrait l’intensité sans le risque, la décision sans le renoncement : c’est impossible. La phronésis est un apprentissage de la liberté. Elle nous oblige à tenir une ligne de crête entre les postures radicales de notre temps. C’est à cette fine pointe qu’il nous faut revenir.
Vers un humanisme du XXIe siècle
« Édifier le projet d’un monde vivable, à échelle humaine, choisir l’horizon du possible sans céder aux oukases sécuritaires : voilà un mot d’ordre possible d’une proposition humaniste de la phronésis au XXIe siècle. »
Conclusion : l’art de la « rigueur élastique »
« Quand un mot apparait, un monde nait avec lui ». Notre raison pratique est capable de conjuguer rigueur et sensibilité, flair et calcul, jugement et émotion, avec une « rigueur élastique ». La phronésis est La vie, mode d’emploi dont parlait Georges Perec. Mais devenir prudent ne se fait pas en un jour. Il faut un temps incompressible pour que sédimente tout un savoir diffus. « Un grand homme naît deux fois, dit Paul Valéry. Comme homme d’abord, comme grand ensuite ». Cette seconde naissance est un long murissement. La phronèsis est fragile, comme nous-mêmes, avec nos limites, nos contraintes et nos doutes. Mais cela vaut la peine : elle débouche sur un art de vivre, et procure un viatique à la pratique de l’incertain.
Parfois cependant, nous n’avons de décisions que tragiques, toutes aussi négatives ou dangereuses de tous côtés. La sagesse du phronimos sera alors de consentir au tragique de l’existence. On peut tromper, déjouer le malheur, mais il faut parfois l’endurer ».
Et ces dernières lignes de Catherine Van Offelen :
Notre prudence s’est fanée. Par ce livre, j’ai essayé de la raviver, d’en déployer les couleurs, la nécessité pratique pour nos générations, et faire entrevoir la grâce qui la nimbe. Que j’y sois parvenue ou non, j’espère que la phronésis cheminera dans le cœur de quelques-uns, comme elle a su cheminer dans le mien.
Risquer la prudence, Une pratique de la sagesse antique, a été publié chez l’éditeur Gallimard le 17 avril 2025. ISBN : 978-2073105257. 184 pages.
Publié le 21 juillet 2025 – Denis Mechali
Donnez-nous votre avis
Partagez votre point de vue avec notre communauté
de passionné·e·s de lecture
Ni votre nom, ni votre adresse e-mail ne seront publiés.