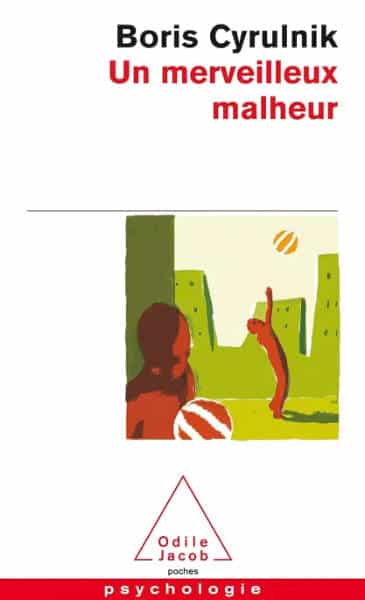
Éditions ODILE JACOB
Un merveilleux malheur
Un ouvrage de Boris Cyrulnik
Une recension de Denis Mechali
Écouter l’accroche de cet article
Neuropsychiatre, éthologue, rescapé de la Shoah, Boris Cyrulnik a consacré sa vie à comprendre les mécanismes de la souffrance et de la reconstruction. Dans « Un merveilleux malheur », il explore le concept de résilience avec une grande précision, loin des formules toutes faites. Un malheur d’enfance, dit-il, n’est jamais « merveilleux » en soi, mais il peut devenir, parfois, le point de départ d’un nouveau récit de vie. À travers des exemples cliniques, des réflexions théoriques et des références littéraires, Cyrulnik tisse un essai subtil et lumineux sur les chemins incertains qui mènent du traumatisme à la reconstruction de soi. Un ouvrage essentiel pour comprendre ce que parler veut dire – et ce que se taire peut révéler.
Denis Mechali
- Temps de lecture estimé à 12 minutes
Ce livre dense, mais accessible, développe une thèse optimiste : les malheurs et les tragédies de l’enfance peuvent parfois être surmontés et mener paradoxalement à des adultes heureux, créatifs, voire reconnus. Cyrulnik expose cette idée avec toutes ses nuances, montrant que ces retournements ne sont jamais automatiques et que, parfois, le malheur initial entraîne la destruction, la mort ou une souffrance durable.
Le cœur du propos : ressort et tricot
Dans sa conclusion, Cyrulnik résume son livre en deux mots révélateurs : « ressort » et « tricot ».
Le « ressort » désigne la résilience, ce concept qu’il n’a pas inventé mais qu’il a largement popularisé. Bien sûr le malheur n’est jamais « merveilleux » en lui-même, mais ses conséquences ne sont pas toujours négatives. Le malheur, en effet, peut provoquer un sursaut, une créativité, un investissement vital qui, eux, vraiment, peuvent « être merveilleux ».
Le « tricot » évoque le tissage complexe de tous ces éléments. Cyrulnik dépasse rapidement la réputation binaire de l’idée de résilience pour révéler sa complexité. Ce tissage est subtil et demande un effort de compréhension pour dépasser une approche trop souvent manichéenne. Pourtant, cet effort vaut la peine, car il nous arme davantage pour comprendre finement les destins individuels, qui tendent à l’accomplissement de soi, une fois le malheur dépassé, compris et « sublimé ».
L’impossible solitude face au malheur
La personne concernée, même si elle joue un rôle essentiel dans l’évolution et les façons de surmonter ses malheurs, ne peut jamais s’en sortir complètement seule. La relation à l’autre est essentielle et souvent même « vitale ». C’est cet autre, ce tiers, qui fonctionne en « tuteur de résilience », pour le meilleur, mais parfois pour le pire. Ce tuteur n’est d’ailleurs pas toujours définitif, et la résilience peut être transitoire, fragile, ou à effets pervers, comme la sortie du malheur par la délinquance, envisagée comme la seule issue possible.
Ce tuteur de résilience peut agir directement en soutenant et en aidant, ou indirectement en poussant à se surpasser par la rage. Parfois même, tout se passe dans le non-dit : un haussement d’épaules ou un regard de commisération peuvent constituer un déclic décisif aux effets durables.
La résilience, une démarche complexe
Le tissage est donc complexe, et il faut un peu mériter ce livre. Mais Cyrulnik, en bon clinicien qu’il a été toute sa vie (et pas seulement théoricien ou chercheur en sciences sociales), donne un très grand nombre d’exemples concrets pour faire comprendre son propos.
Le psychanalyste Michael Balint avait d’ailleurs la même démarche pour faire comprendre les rouages de la maladie et le tissage à l’œuvre (encore ce mot !) entre le médecin et son patient.
Ce livre est vraiment important, de mon point de vue, dans une période qui assène des vérités tranchées, dont il est parfois difficile, voire impossible de se départir. Cyrulnik aide à démêler la pelote, à comprendre pourquoi le récit de soi peut être mensonger, volontairement ou non.
Les mécanismes de dépassement
Cyrulnik décrit les mécanismes psychologiques permettant de surmonter les traumatismes : le clivage entre réalité extérieure et intérieure, le déni, la rêverie qui réinvente le réel, et surtout l’humour, élément clé pour surmonter et dire l’innommable. Ces processus suivent souvent une progression en trois actes : désolation, réparation, puis triomphe.
L’auteur décortique les paradoxes, ces « oxymorons » que constituent les vérités apparemment contradictoires, mais simultanément présentes. Ainsi, un malheur d’enfance peut rendre la réussite sociale vitale, et donc tangible. On peut aimer et détester la même personne : « Je t’aime et je te fais souffrir, comme j’ai subi enfant avec mes parents que j’aimais, mais qui étaient mes bourreaux. » Bien sûr, ces mécanismes ne sont jamais constants ni automatiques et peuvent être transformés par d’autres rencontres.
Un récit en remplace un autre…
Quant au récit de soi, pourquoi peut-il être refusé à un moment, accepté à un autre, mais parfois sous une forme idéalisée, qui rend alors le « témoignage » excessif, rigidifié et finalement faux ?
Certains sujets de société sont devenus essentiels en 2025, comme les maltraitances, physiques, psychologiques ou sexuelles infligées aux enfants, ou les violences subies par les femmes. Par ailleurs, ces sujets deviennent si forts et si partagés que l’esprit critique, et, en soi, les éléments discutables du témoignage ou du récit, finissent par devenir inaudibles ou impossibles à dire.
Guy Béart chantait : « Le premier qui dit la vérité sera exécuté » et la poésie exprimait ce qui, parfois, va paralyser la parole, et parfois même, en amont de la parole, la pensée elle-même.
Il en va de même pour le récit de soi. Un déni est alors remplacé par un autre, un mensonge par un autre, entrainant un sentiment de trouble. Que croire ? Qui croire lorsque de tels retournements, ou de tels effets pervers sont observés ?
À vrai dire, cela n’a rien d’insoluble. Cyrulnik explique bien que la solution passe par du travail, de la réflexion et que l’on ne peut pas faire l’économie de ce travail de lucidité, de tricotage et de détricotage de chacun de ces points. Il y a un prix à payer, acceptable pour certains, et beaucoup trop élevé pour beaucoup d’autres. Il n’y a pas de place pour une réponse trop globale ou trop « paresseuse ».
On ne s’étonnera pas trop que Boris Cyrulnik et Edgar Morin aient de l’estime mutuelle au point d’avoir écrit des livres ensemble. Leur vision, des mécanismes de la résilience pour Cyrulnik , ou de la complexité pour Morin, ont des points communs, de cette idée du travail acharné, avec une lucidité à vif, envers les autres, mais également envers soi-même.
On retrouve, chez ces deux auteurs, un « Connais-toi toi-même socratique », puis une sagesse à la Montaigne, pour éviter, autant que se peut, de fustiger les vices ou défauts des autres, en étant aveugles à ses propres facilités, dénis ou blocages…
Contresens et récits en trois temps
La précision, c’est aussi de comprendre des petits contresens évitables. Ainsi, dit Cyrulnik, être triste ou malheureux, lorsque la vie est dure, n’est pas synonyme de « dépression ». C’est juste que « plus la vie est dure, plus on a de chances de la trouver dure » ! Dit comme ça, cela semble idiot, mais il s’agit de bien comprendre que souffrance et tristesse ne sont pas des signes de dépression. Tout simple donc, mais bien des traitements anxiolytiques ou antidépresseurs ne seraient pas prescrits (et pris), si l’on tenait compte de cette simple différence.
Cyrulnik décrit ainsi « Les récits de soi qui marchent », au sein de la littérature, en trois actes habituels : Désolation, puis réparation, et enfin triomphe. C’est sur ce modèle que Charles Dickens a composé son livre Oliver Twist. Ces déroulements supposent que l’on a pu utiliser d’abord, puis dépasser des mécanismes psychologiques tels que le clivage (une réalité extérieure ou sociale, et une autre réalité intérieure et intime) ou le déni (cette réalité douloureuse n’existe pas), complété ou suppléé par la « rêverie » (un réel inventé ou réinventé), et enfin l’humour, élément clef pour surmonter et dire, y compris l’innommable.
Ainsi, en parlant de choses subies à Auschwitz, on peut repérer de nouveau trois temps : raconter en se moquant, supporter l’insupportable, et, si on a survécu, constater que l’on a été vainqueur de telles horreurs. Mais alors, « vainqueur » ? dit encore Cyrulnik : c’est à mourir de honte, ou à mourir de rire…
De l'importance du contexte
Prenons garde aux anachronismes ! Des éléments de contexte, précis, comme la vulnérabilité naturelle des enfants, et leurs fréquentes morts en bas âge, mais aussi liées aux vies d’adultes, expliquent que la maltraitance infligée aux enfants a été longtemps impossible à envisager, et est restée hors du champ de conscience de la plupart des adultes. Trop d’enfants mouraient en bas âge pour que puisse s’exercer notre sollicitude contemporaine. Un contexte social vient se surajouter aux éléments individuels, pour penser la maltraitance enfantine, devenue, à notre époque, souvent – ou en théorie – insupportable et intolérable.
Si « cela se fait » de taper les enfants, cela n’est même pas pensé, en tout cas reste hors de la pensée de tous ceux que la « pensée de groupe » sécurise et rassure, et qui ne peuvent pas (ou ne veulent pas) s’en décaler. Ils ne sont pas méchants. Ils sont juste pris dans ce besoin d’appartenance.
Les récits répétitifs d’inceste ou de violences physiques infligés par un père, avec une mère semblant sourde, aveugle ou insensible, doivent tenir compte de ce type d’éléments, faute de quoi on se livre volontiers à des indignations « mécaniques », trop faciles.
On se donne le beau rôle, en jugeant, alors que l’on n’a pas l’implication affective ou « sociologique » qui existait dans la réalité.
Le malheur intime n’est pas exclusivement social ou lié à des évènements traumatiques collectifs. Une étude intéressante a suivi aux États-Unis, sur une très longue période, la vie de jeunes hommes riches et privilégiés. 30% environ avaient subi un malheur intime. S’en sortir ou non, s’observait dans le même pourcentage, approximativement, que chez les personnes issues de milieux défavorisés. Cela ne veut pas dire que tout se vaut, mais que les facteurs en cause, très différents les uns des autres, ne doivent pas être mélangés. Il faut au contraire les distinguer, les repérer, et mieux comprendre ainsi les conséquences lointaines.
Pour ce type d’observations et d’études, les professionnels ne sont pas forcément à l’abri d’erreurs. Le « biais du professionnalisme » peut les amener à voir en consultation les enfants ou anciens enfants qui ne s’en sortent pas bien.
Ceux qui ont surmonté vont bien et ne consultent pas. Ils sont donc invisibles pour les professionnels.
À tuteur identique, des éléments intérieurs expliquent le type de réponse, ou l’absence de réponse. Certains s’en sortent en choisissant des « métiers de contexte », proches de ceux proposés par le tuteur de résilience. D’autres, qui se sont plutôt réfugiés dans l’abstraction, s’en sortent en exerçant des métiers de la créativité : ils écrivent des livres, jouent au théâtre ou sont metteurs en scène. Ils peuvent parler de leur trauma sans en parler directement, en le figurant autrement. « Antériorité et alentours » sont les clefs des virages existentiels, des choix de vie essentiels. Souvent.
Le dilemme de la parole et du silence
Pour parler, il faut être écouté. Si on n’est pas écouté, on se tait. Mais, pour être écouté, il faut parfois livrer un récit « acceptable », une vérité un peu aseptisée, un peu modifiée. Ces dilemmes peuvent expliquer des inversions de sens, des « témoins » qui deviennent les récitants mécaniques d’un récit qui plait, et parfois de plus en plus éloigné de la vérité initiale. Ou qui s’aperçoivent que c’est le plus sordide de leurs récits qui est apprécié, par une sorte de « gourmandise émotionnelle » un peu malsaine, assez « voyeuriste », et loin de la compréhension vraie et empathique qu’ils espéraient.
Georges Pérec voulait parler « d’eux ». Eux, ses parents disparus à Auschwitz. Il ne le pouvait pas directement, Alors il n’en a pas parlé, et écrit « La disparition », livre sans la lettre e, donc « sans eux ». Il a aussi écrit « Je me souviens », collection de souvenirs dérisoires. Mais les auditeurs ayant vécu au même moment se retrouvent dans ces souvenirs dérisoires, et cela crée un sentiment de solidarité, d’appartenance. Mieux que rien pour un homme comme Pérec…
Les récits sont ainsi reçus, ou déniés, selon le contexte, selon la période. Primo Levi écrit « Si c’est un homme en 1946, à la sortie de la guerre. Personne ne veut trop savoir, avoir les détails des horreurs subies, il vend 70 exemplaires de son livre. En 1962, une génération a passé, savoir est possible, le livre est réédité, et il en vend 200 000.
Parfois, faute de pouvoir dire, on va « para-dire », livrer un récit paraphrastique… Cyrulnik raconte le cas de cette femme qui quittait la pièce lorsque le mot « inceste » était prononcé, amenant son enfant à comprendre ce qu’avait vécu sa mère, via cette répétition même de l’attitude, sans qu’aucun mot ne soit jamais prononcé.
Récits ou non récits, on observe souvent l’évolution en trois générations : la première n’en parle pas, pour se protéger et protéger les enfants. La seconde bénéficie de ces efforts, et de ces silences. Elle ne cherche pas à en savoir plus ou ne franchit pas le silence des parents. La troisième génération veut savoir, connaître ses racines, et interroge ou enquête, directement ou indirectement…..
On ne peut pas, et on ne doit pas « tout dire ». Les éléments de contexte sont inévitables à prendre en considération. Cyrulnik raconte le cas d’une femme ayant eu des relations, au début de son mariage, avec son beau-père. Elle n’en parle pas à son mari, très longtemps, puis, un jour, se confie à lui. Le mari se suicide…. Les dilemmes ne sont pas toujours vains, et la place réciproque du courage et de la lâcheté, de la parole ou du silence, n’est ni mécanique ni tracée d’avance…
Pour conclure…
Dans sa conclusion, Cyrulnik cite une phrase de Cioran : « La résilience, c’est plus que résister, c’est aussi apprendre à vivre. Malheureusement, cela coûte cher ».
Un merveilleux malheur, édition originale, 1993 ; Poches Odile Jacob », 2002.
218 pages.
ISBN : 978-2738111258
Publié le 5 juillet 2025 – Denis Mechali